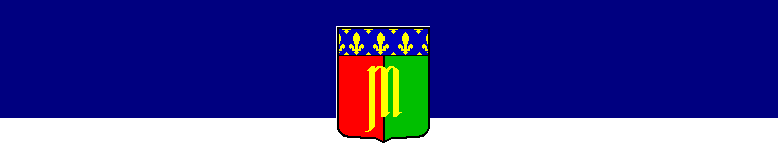
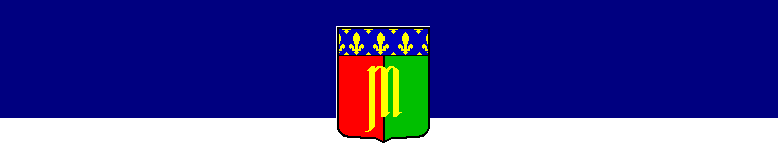
La bataille de Crécy 1346
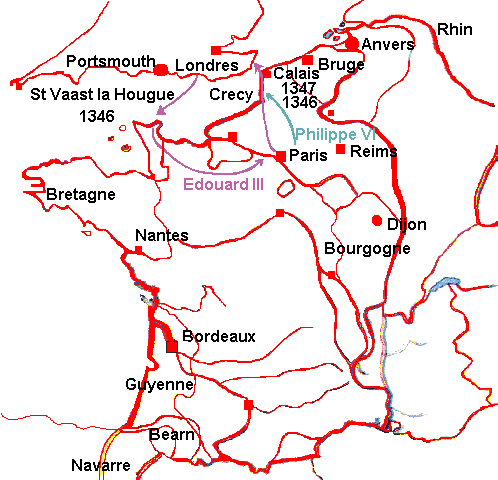
 Caen.
Crécy. Calais (1346-1347). - Édouard III préparait un nouveau débarquement,
qu'il ne savait encore où fixer, lorsque son adversaire lui épargna de
trop longues hésitations en condamnant a l'exil un grand seigneur normand,
Geoffroy d'Harcourt, lequel courut se mettre au service des Anglais, leur
offrant libre accès en Cotentin. Le butin qu'Édouard fit a Caen - où le
connétable de France fut fait prisonnier - faillit bien arrêter la campagne.
Car ses vaisseaux de ravitaillement portèrent les draps normands a Londres
et tardèrent a revenir.
Caen.
Crécy. Calais (1346-1347). - Édouard III préparait un nouveau débarquement,
qu'il ne savait encore où fixer, lorsque son adversaire lui épargna de
trop longues hésitations en condamnant a l'exil un grand seigneur normand,
Geoffroy d'Harcourt, lequel courut se mettre au service des Anglais, leur
offrant libre accès en Cotentin. Le butin qu'Édouard fit a Caen - où le
connétable de France fut fait prisonnier - faillit bien arrêter la campagne.
Car ses vaisseaux de ravitaillement portèrent les draps normands a Londres
et tardèrent a revenir.
L'Anglais ébaucha
donc une retraite vers le Ponthieu, qu'Édouard I avait possédé par mariage,
mais qui venait d'être théoriquement saisi par la France en 1337. L'armée
des Français gardant la Seine, l'ennemi fut contraint de la suivre jusqu'a'
Poissy avant de trouver un passage et de franchir le fleuve. Cela s'accomplit
a la faveur d'une feinte sur Paris qui rejeta le roi de France, décidément
facile a berner, dans la ville. Philippe reprit cependant la poursuite. Édouard,
après avoir franchi, non sans combat, la Somme au gué de la Blanchetaque,
le 23 août, résolut d'attendre son adversaire. Peut-être, jugeant le heurt
désormais inévitable, préférait-il choisir en Ponthieu son terrain de résistance.
 La
faiblesse de ses effectifs - 9 000 hommes à peine contre 12 000 Français -
lui commandait non l'attaque, mais la défensive. Il adossa ses troupes
à un bois, sur un coteau près de Crécy, face au levant; il entoura d'une
palissade les chevaux et le charroi.
La
faiblesse de ses effectifs - 9 000 hommes à peine contre 12 000 Français -
lui commandait non l'attaque, mais la défensive. Il adossa ses troupes
à un bois, sur un coteau près de Crécy, face au levant; il entoura d'une
palissade les chevaux et le charroi.
Dans l'après-midi du 26 août, ses soldats sont assis dans l'herbe, le bassinet posé devant eux, reposés, ragaillardis par les vins du Poitou qu'ils viennent de piller sur les vaisseaux rochelais ancrés dans le port du Crotoy. Ils regardent déboucher de la chaussée Brunehaut la grande cohue des féodaux français. La victoire des Anglais à Crécy fut une victoire de l'obéissance sur l'indiscipline, de l'organisation sur l'imprévoyance, de l'arc anglais sur l'arbalète génoise.
En l'absence
du connétable de France, Philippe VI accumula les fautes, dont la première
fut d'engager l'action sans avoir laissé reposer hommes ni chevaux.
Mais n'y avait-il pas près de sept ans qu'on frustrait les chevaliers
d'une bataille, par trêve pontificale ou autrement? ils ne savaient plus
attendre. Les arbalétriers génois furent en premier sacrifiés. « Tuez
toute cette ribaudaille, car ilz nous empeschent la voie! » cria le roi.
Les hommes d'armes foncèrent alors aussi follement que l'aveugle roi
de Bohème, qui s'était fait lier à ses compagnons; ils trébuchèrent sur
les corps des piétons, furent pris à revers par la grêle de flèches des archers,
par les boulets de quelques bombardes, ou luttèrent vainement jusqu'à
la nuit tombée. Jean de  Hainaut
arracha Philippe VI au champ de bataille.
Hainaut
arracha Philippe VI au champ de bataille.
Deux jours après un succès aussi éclatant qu'imprévu, Édouard III reprenait sa fuite vers le nord. Il lui fallait un port pour se rembarquer, peut-être aussi pour assurer les campagnes futures. Renonçant à Boulogne, l'Anglais fit porter son effort sur Calais, qui semblait plus vulnérable, mais qui, tenace, et sérieusement ravitaillé par la marine normande, résista un an. Par terre, Philippe VI intervint trop tardivement et mollement.
Se heurtant aux tranchées que, tel César devant Alésia, Édouard avait creusées devant son campement de siège (Villeneuve la Hardie), il se retira. Le 4 août 1347, la ville tombait, et les six bourgeois pris comme boucs émissaires ne durent leur salut qu'aux prières de la reine Philippa. Mais des Anglais remplaceraient dorénavant les habitants chassés de leur ville. Une trêve fut conclue avec Philippe, laquelle devait se prolonger jusqu'à la fin du règne.